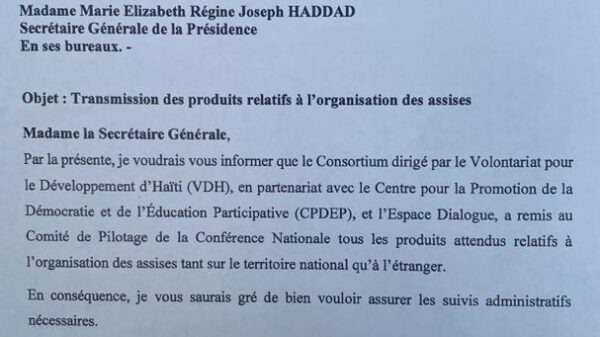Vingt-deux mois après son installation, le pouvoir intérimaire arrive au terme d’un mandat marqué par l’extension de l’insécurité, la paralysie institutionnelle et le désarroi économique. Présenté comme une étape de stabilisation et de transition, ce régime de facto a, dans les faits, accompagné une aggravation des violences, une fragmentation accrue de l’autorité de l’État et une perte massive de confiance citoyenne. L’heure du bilan n’est plus un simple exercice de style politique : c’est un impératif de lucidité nationale et de responsabilité historique.
De l’espoir à l’entropie politique
À son origine, le régime intérimaire reposait sur un contrat symbolique : rétablir la sécurité, restaurer les institutions et préparer les conditions d’un retour à la normalité constitutionnelle. À ce moment précis, une large partie de la population, bien que méfiante, a accepté cette solution dite “provisoire” au nom d’un pragmatisme contraint : il fallait au moins un interlocuteur étatique pour faire face à la décomposition accélérée du pays. En ce sens, ce pouvoir est arrivé avec un capital de tolérance, sinon de confiance, et une fenêtre d’opportunité limitée mais réelle. Ce mandat triptyque, politique, institutionnel et sécuritaire, relevait d’une équation rationnelle clairement définie : sans sécurité, pas d’institution ; sans institution, pas de légitimité ; sans légitimité, pas de gouvernance.
Mais le système a implosé dès ses premières contradictions internes. Ce qui rend le bilan actuel si sévère, c’est précisément l’écart entre ce qui était attendu, un minimum de stabilisation, et ce qui a été livré : une aggravation du désordre, doublée d’un sentiment de trahison des engagements les plus élémentaires. La science politique enseigne que tout régime de transition doit posséder trois piliers, la cohérence des acteurs, la clarté des objectifs, et le contrôle des ressources coercitives. L’intérim haïtien n’a rempli aucun de ces critères. Résultat : une entropie politique croissante, où chaque initiative, au lieu de rétablir l’ordre, a renforcé la désorganisation.
Les images de Port-au-Prince incendiée, les entreprises saccagées, les quartiers soumis à la peur, traduisent plus qu’un échec conjoncturel, elles expriment la dérégulation totale du pouvoir étatique.
Gouverner l’imprévisible : le paradoxe haïtien
Le pouvoir intérimaire, qui se présentait comme celui du rétablissement progressif de l’ordre, a laissé se constituer un véritable archipel de territoires soustraits à l’autorité publique. La mission première, garantir la protection minimale des personnes et des biens, n’a pas été remplie. Dire que “les autorités ont failli à leur mission” n’est pas qu’un jugement moral, c’est un constat factuel. l’État, dans ses fonctions régaliennes de sécurité, n’a pas repris le terrain perdu, il en a cédé davantage.
Les théories contemporaines de gouvernance post-crise (notamment celles de Francis Fukuyama ou d’Acemoglu & Robinson) rappellent que l’État ne se sauve jamais dans le provisoire. Or, l’intérim haïtien a voulu transformer la transition en méthode de gouvernement. C’est là le cœur du paradoxe, en cherchant à temporiser, il a institutionnalisé l’attente. Les pouvoirs publics n’ont produit ni plan de stabilité à moyen terme, ni calendrier électoral crédible, ni réforme structurelle. Cette procrastination institutionnelle a transformé l’État en simple gestionnaire du quotidien, sans projet global ni légitimité populaire. Sociologiquement, cela relève du syndrome de la gouvernance intérimaire, un mode d’administration qui gère la survie sans transformer la réalité.
Le délitement institutionnel comme fait systémique
Vingt-deux mois ont suffi pour révéler que la fragilité haïtienne n’est pas seulement fonctionnelle, mais systémique. Le délitement institutionnel touche à la capacité même de l’État à produire de la norme et à faire appliquer l’autorité.
En termes de théorie politique, l’État haïtien se trouve dans ce que les chercheurs nomment un “effondrement capacitaire”, c’est-à-dire un moment où les institutions ne parviennent plus à articuler ni vision ni exécution. C’est le fonctionnement même de l’appareil institutionnel qui s’est progressivement grippé. Ministères désarticulés, annonces sans mise en œuvre, commissions créées puis abandonnées, textes promis mais jamais appliqués, tout concourt à donner l’image d’un État qui parle beaucoup et agit peu. Les forces de sécurité, dépourvues de moyens et de commandement unifié, incarnent ce vide de souveraineté. Le pouvoir civil, incapable de les orienter, a choisi la voie commode du déni. Pendant ce temps, les structures sociales non étatiques, groupes armés, associations locales, réseaux religieux, ont reconfiguré le champ du pouvoir, devenant les véritables gouvernants de facto. Dans ce contexte, l’État cesse progressivement d’être perçu comme un arbitre ou un protecteur, et devient un acteur lointain, opaque, souvent indifférent au sort quotidien des citoyens.
Économie politique du désastre
Sur le plan économique et budgétaire, l’un des reproches les plus lourds concerne l’usage des ressources publiques. Des milliards de gourdes ont été mobilisés au nom de la stabilisation, de la réponse à la crise et du soutien aux populations vulnérables. Or, les résultats observables sur le terrain sont dramatiquement faibles. L’approche empirique montre également que la transition a échoué à stabiliser l’économie. En l’absence de planification et de transparence budgétaire, les flux financiers ont essentiellement servi la préservation du statu quo.
Les « milliards gaspillés » ne sont pas qu’un argument médiatique, ils traduisent un phénomène que les économistes appellent captation politique des ressources, l’appropriation des fonds publics par des acteurs institutionnels sans régulation ou reddition de comptes. Quand la population constate que des sommes considérables ont circulé, sans amélioration concrète de sa sécurité, de sa mobilité, de son accès aux services, l’idée de “billions gagotés”, pour reprendre l’expression populaire, n’est pas une simple phrase choc, c’est la façon dont un peuple traduit l’impression d’avoir été à la fois utilisé et abandonné.
Haïti est ainsi entrée dans une spirale où l’économie informelle et la corruption s’alimentent mutuellement. Les petits entrepreneurs, frappés par l’insécurité et l’instabilité monétaire, se replient ou s’exilent, accélérant le processus de désindustrialisation du territoire national.
Crise de légitimité et effondrement symbolique
L’un des marqueurs les plus implacables de ce mandat est l’effondrement de la légitimité. Au fil des mois, la distance entre le pouvoir et la population s’est creusée, au point que la parole gouvernementale a perdu presque toute capacité à convaincre ou à mobiliser. La légitimité d’un pouvoir, rappelle Max Weber, se définit par la reconnaissance sociale de son autorité. Or, plus aucune couche de la société haïtienne ne reconnaît celle du régime intérimaire.
La légitimité traditionnelle, fondée sur la coutume et le respect du pouvoir, a disparu depuis longtemps. La légitimité légale,issue des institutions, est aujourd’hui caduque. Quant à la légitimité charismatique, elle n’a jamais existé, car ce pouvoir ne s’est jamais forgé dans la conviction ni dans le leadership. Le résultat, c’est une délégitimation totale, l’État parle mais n’agit pas, promet mais n’accomplit rien. Dans les quartiers populaires, la loyauté s’est déplacée vers des structures informelles qui offrent protection, aide ou influence. Le pouvoir central, lui, demeure prisonnier d’un langage creux, incapable de recréer le lien entre dirigés et dirigeants.
Vers une refondation épistémique et politique
L’échec n’est pas seulement technique ou administratif ; il est aussi moral. Car au-delà des chiffres, des budgets et des textes, un pouvoir se juge à sa capacité à assumer ses responsabilités, à reconnaître ses fautes, à ne pas déguiser la réalité. Ce décalage entre le discours et le réel crée un ressentiment profond : les citoyens ne se sentent pas seulement en danger, ils se sentent méprisés dans leur intelligence et leur expérience. C’est là que la crise politique rejoint une crise de confiance radicale. Reconnaître cet échec massif implique une approche scientifique du redressement national. On ne reconstruit pas un État sur la base d’émotions, mais sur des données : sécurité mesurable, gouvernance traçable, participation observable. Autrement dit, Haïti doit passer d’une culture de l’urgence à une culture de la projection.
Refonder, ce n’est pas remplacer des hommes ; c’est redéfinir le contrat social. Cela suppose une recherche sérieuse, pluridisciplinaire, combinant politologie, économie du développement et sociologie des crises. Les universités, les think tanks haïtiens et la diaspora scientifique doivent redevenir des acteurs du débat public, non de simples spectateurs du naufrage. C’est dans cette articulation entre savoir et action que réside la voie d’un vrai redressement.
L’heure de la lucidité nationale
À quelques jours de la fin du mandat, la question n’est plus de savoir si ce pouvoir a réussi ou non. Les faits ont tranché : l’insécurité est plus vaste, l’économie plus fragile, les institutions plus discréditées. La question centrale est désormais : que faire de cet échec ? L’heure du bilan est aussi celle de la lucidité. Ce pouvoir intérimaire s’éteint dans la confusion et l’échec, mais la leçon dépasse son cas particulier : c’est toute la logique du provisoire qui doit être remise en question. Il ne suffit plus de changer de dirigeants ; il faut changer de paradigme. Car un État ne se réforme pas sans s’étudier, et une nation ne survit pas sans se comprendre.
Au terme de ces vingt-deux mois, l’histoire retiendra un pouvoir intérimaire qui, placé devant une responsabilité immense, n’a pas su être à la hauteur du moment. Elle retiendra un centre-ville éventré, des entreprises ruinées, des familles déplacées, des milliards dilapidés, et une population laissée seule face à la peur. Mais l’histoire retiendra aussi que, malgré tout, la société continue de témoigner, d’écrire, de dénoncer, de penser. C’est dans cette mémoire vive, celle des victimes, des témoins, des analystes, des journalistes, des citoyens ordinaires, que se trouve la véritable ressource pour refuser la normalisation du chaos.
L’heure du bilan, c’est celle où un peuple regarde en face ce qui lui a été fait, ce qui lui a été promis, ce qui lui a été refusé. C’est l’heure où la lucidité devient une forme de résistance, et où la vérité, même douloureuse, prépare les conditions d’un sursaut.
- CPT: l’heure du bilan - 28 janvier 2026
- Non, Smith Augustin n’est pas un nationaliste - 22 janvier 2026
- 12 janvier 2010 – 12 janvier 2026 : seize ans après, la mémoire reste vive! - 12 janvier 2026