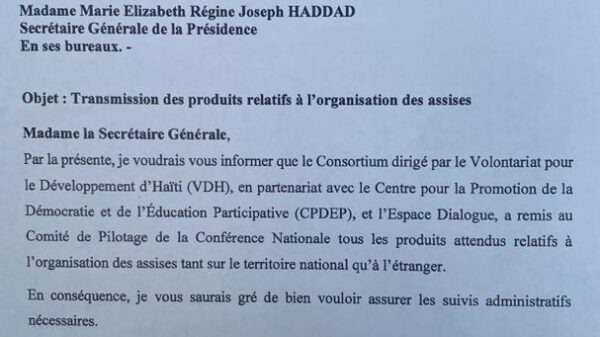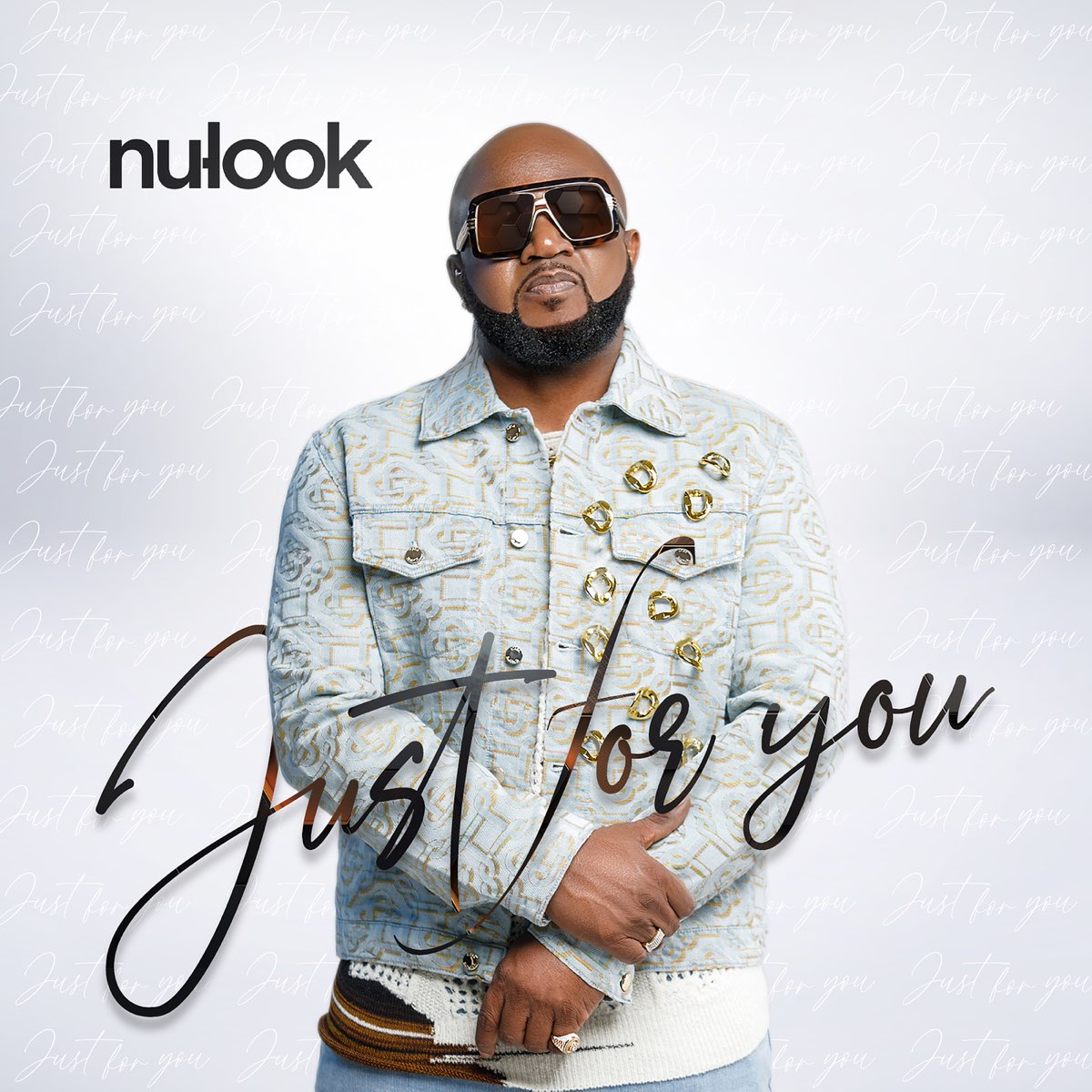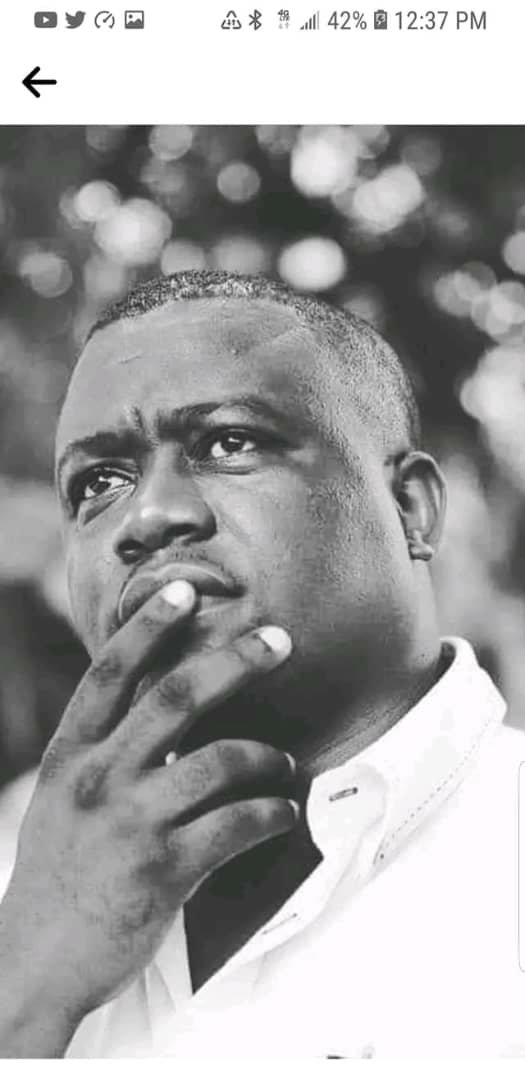Port-au-Prince, septembre 2025 — Qu’est-ce qu’un empire chancelant, sinon le fruit d’une longue agonie tissée dans le déni, l’arrogance, la cupidité et l’incompétence ? Haïti traverse, sous nos yeux, le crépuscule d’un système à bout de souffle, où la violence, l’abandon et la débâcle morale occupent tout l’espace laissé par l’État en déroute. Un État atomisé, l’incapacité érigée en principe.
En 2025, toute la structure de gouvernance haïtienne n’est plus qu’un édifice lézardé. Après des années de transitions, de promesses constitutionnelles stériles et de dialogues de façade, la présidence, le gouvernement, les forces de l’ordre et le pouvoir judiciaire n’inspirent que la défiance. Le Conseil Présidentiel de Transition (CPT), né dans la douleur, n’est parvenu ni à rallumer la flamme démocratique ni à mobiliser la société contre la barbarie quotidienne. La corruption continue de gangréner l’administration : les cadres compétents fuient ou démissionnent face à l’inanité des institutions. Dans les ministères, la vacuité règne. Certains dirigeants deviennent les symboles de l’incompétence, parfois ouvertement dénoncés par la société civile et la presse. Cette tragédie institutionnelle se double d’un divorce croissant entre élites politiques et citoyens ordinaires.
La violence, matrice et symptôme du chaos
En 2025, Haïti détient le sinistre record du nombre de personnes déplacées par la violence en Amérique : plus de 1,4 million d’êtres humains fuient la terreur des gangs. Jamais le contrôle territorial des groupes armés n’a été aussi vaste. Aucune zone du pays n’est à l’abri : Port-au-Prince est morcelée en partitions criminelles, les routes nationales sont régulièrement coupées, les communautés rurales sont assiégées. Aujourd’hui, aucune route reliant un département à un autre n’est accessible sans soumission à la loi des bandes armées. Les citoyens, pris en étau, doivent s’acquitter d’une « taxe du désespoir » directement versée aux bandits, et souvent leur passage dépend du simple caprice de ces maîtres du territoire. Parfois, même l’argent versé n’est pas suffisant pour garantir de passer ; il faut, en plus, que les bandits soient de bonne humeur pour espérer traverser. La circulation, jadis droit fondamental, s’est muée en privilège aléatoire, négocié dans la peur et l’humiliation. La carte du pays s’est transformée en une mosaïque d’enclaves hostiles où la mobilité relève du miracle, et où la peur ronge chaque déplacement.
Les enlèvements, les assassinats, les massacres de familles entières se répètent, semant la psychose et la désolation. De nouveaux modes de terreur émergent, comme les attaques de drones artisanaux utilisés contre les civils. Les écoles ferment par centaines, les enseignants ou élèves sont ciblés ; l’accès aux soins de santé est désormais impossible pour plus de 40% de la population. Cette sauvagerie politique prolifère d’autant plus librement que la police nationale, dépassée, mal équipée, infiltrée par la corruption et l’épuisement, renonce peu à peu à assurer sa mission. Les milices d’autodéfense endossent à leur tour la violence, multipliant les lynchages ou les représailles aveugles.
Corruption, impunité et trahison
Jamais la pourriture morale de l’État n’a semblé aussi profonde. Les scandales de corruption touchent absolument tous les niveaux du pouvoir : du Conseil Présidentiel de Transition aux ministres, en passant par leurs affidés et conseillers. Les marchés publics surévalués, les contrats fictifs, les détournements de fonds, les nominations de complaisance rythment le quotidien. Toutes les instances sont touchées : le crime ne se cache même plus. Certains n’accèdent à des postes qu’en vertu de leur proximité avec les pouvoirs mafieux, et la manne publique est vampirisée à un rythme effréné, les intérêts particuliers balayant tout sur leur passage. La société civile, les médias, des voix isolées dénoncent, mais se heurtent à une chape d’indifférence, de menaces ou de tentatives de corruption.
Le CPT, fruit d’un compromis accepté par lassitude plus que par conviction, avait pourtant suscité quelques maigres espoirs. Malgré le rejet d’une large frange de la société, la gravité de la crise avait poussé à céder à l’expérience, à croire qu’une transition contrôlée serait synonyme de stabilité. Mais la désillusion a été immédiate et totale : au lieu de remplir une mission de salut public, le CPT a fait pire que ses prédécesseurs, ne gouvernant que pour lui-même, dans un aveuglement cynique. La feuille de route, censée être une boussole — sécurité, réforme, référendum, élections — n’a même pas été consultée une seule fois ; jamais débattue véritablement. Trop occupé à se partager les prébendes et à garantir ses propres intérêts, le CPT a laissé le peuple haïtien errer dans la nuit, abandonné, saigné, sans la moindre perspective de restauration du bien commun.
Humanitaire : la dévastation totale
À cette hécatombe institutionnelle, il faut ajouter la plus grave catastrophe humanitaire de l’histoire du pays. Plus de 6 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, requièrent une aide d’urgence : vivres, eau potable, abris, accès aux soins, protection. La faim ronge 48% des Haïtiens, avec des milliers au bord de la famine et de la malnutrition aiguë. La résurgence du choléra, endémique depuis 2022, exacerbe la tragédie. Près de 90 000 cas suspects sont rapportés début 2025, favorisés par l’effondrement total des infrastructures d’eau et d’assainissement. Les structures hospitalières sont sinistrées : 40% des centres sont fermés et les 33% restants ne peuvent fonctionner qu’à moitié, faute de personnel, d’approvisionnement, ou parce qu’ils sont la cible directe des groupes armés.
Le sort des enfants est particulièrement cruel : meurtres, recrutements forcés dans les gangs, violences sexuelles et exploitation atteignent des niveaux historiques, parfois sous le regard impuissant ou complice des institutions officielles.
Port-au-Prince, capitale prise en otage
La capitale incarne elle seule la faillite du modèle haïtien. L’aéroport Toussaint Louverture n’est plus desservi par la plupart des compagnies aériennes, et l’accès routier à la ville est formellement déconseillé en raison des attaques et barrages contrôlés par les gangs. Sortir ou entrer dans Port-au-Prince est devenu pour la majorité des Haïtiens une aventure mortelle. Les frontières avec la République dominicaine restent fermées, accentuant l’enfermement national et l’isolement économique. La violence des affrontements se conjugue à la terreur psychologique : attaques nocturnes, pillages d’entrepôts humanitaires, incendies criminels, exil massif des familles de la classe moyenne et des professionnels, tous fuyant le spectre de l’effondrement total.
Impuissance, duplicité et abdication
Face à la déferlante de la violence, les autorités politiques et policières se contentent trop souvent d’un discours lénifiant ou d’un repli sécuritaire inefficace. Les promesses d’un soutien international, d’une résurgence institutionnelle, ou même d’élections démocratiques semblent dérisoires au regard de l’ampleur du désastre et de l’accumulation de promesses non tenues. Nombre d’acteurs accusent le gouvernement de complaisance, de passivité, voire de complicité active avec les criminels. Le divorce entre la société et les élites dirigeantes atteint un niveau rarement observé dans l’histoire moderne.
Aujourd’hui, Haïti ne se contente plus de tomber : elle s’effondre, lentement, méthodiquement, dans la complicité silencieuse d’une oligarchie qui, ayant tout sacrifié à ses propres intérêts, laisse la nation entière à genoux, otage du cynisme, de la peur et de l’oubli.
- Le CPT : aveu d’un échec - 9 janvier 2026
- C’est fini, le CPT déjà enterré et oublié ! - 3 janvier 2026
- Haiti: la transition permanente comme stratégie de pouvoir - 31 décembre 2025